Journaliste, Anaïs Bouton est connue pour son franc-parler, un trait de caractère que l’on retrouve dans son émission sur LCI « En Toute Liberté », qui fait de très belles audiences. La présentatrice publie Tenaces, un ouvrage né de dizaines de rencontres avec des femmes aux parcours singuliers. Des femmes qui ont tenu, résisté, avancé, souvent contre les évidences. Dans cet entretien, elle raconte ce que signifie pour elle la ténacité, ce qui l’a frappée dans ces trajectoires de femmes , son regard de journaliste féministe, et pourquoi elle a choisi de livrer aussi une part de son histoire. Rencontre exclusive pour The Women’s Voices.
Qu’est-ce que la ténacité signifie pour vous ?
C’est tout.
C’est essentiel. C’est un fil conducteur de vie. C’est très important.
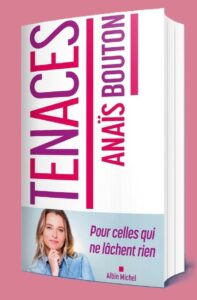
C’est ce qui vous a intéressée chez les femmes que vous avez interviewées ?
Oui, c’est ça.
En fait, tout a explosé d’un coup avec #Metoo. Je me suis dit : waouh, je n’avais pas du tout conscience de l’ampleur des choses. Chacune vivait sa petite vie, il n’y avait pas vraiment de prise de conscience.
Et je me suis rendue compte que ça ne concernait pas uniquement les violences sexuelles. C’est toute la vie des femmes, en fait. Tout à coup, la parole des femmes se déverse.
Elles ont plein de choses à dire, à proposer. Une manière de vivre leur vie droite, d’assumer ce qu’elles sont, d’essayer de comprendre qui elles sont vite, et d’être en accord avec elles-mêmes.
Ça me paraît fondamental.
Vous donnez une place centrale à des profils comme Tatiana Briant, négociatrice du RAID, ou Véronique Béchu, commandante de police. Qu’est-ce qui vous a frappée dans ces métiers très difficiles ?
Il y a notamment Martine Monteil, la première patronne de la PJ, qui me raconte que quand elle est arrivée, il y avait écrit : « La police, un métier d’homme ».
Moi, je suis une fille des années 70. Il y avait des métiers d’hommes.
Je me suis intéressée à ces femmes parce que je me suis demandé : comment on fait pour avoir une vocation quand, a priori, ce n’est pas prévu pour vous ?
Ces femmes-là ont cassé des barrières.
Parmi toutes les femmes que vous avez rencontrées, y en a-t-il une qui vous a particulièrement marquée ?
Honnêtement, je ne peux pas faire de palmarès.
Dans chacune d’elles, j’ai trouvé des choses pour me nourrir. Et quand les gens lisent le livre, ils me disent souvent que c’est passionnant, encourageant, très positif de voir tous ces parcours.
Mais il y en a une qui me bouleverse à chaque fois : la professeure Céline Greco.
C’est une femme qui a été une enfant victime. Son parcours de petite fille battue est bouleversant. Et ce qu’elle en a fait est incroyable.
Elle est devenue professeure spécialisée dans la douleur à l’hôpital Necker et a monté une association, IM’PACTES, où elle récupère des enfants de l’aide sociale à l’enfance.
C’est une résilience folle. Je l’ai en tête parce que je l’imagine petite, battue par son père, forcée à faire du piano quinze heures par jour. Elle a eu une enfance d’une violence totale.
Et aujourd’hui, c’est probablement l’une des personnes les plus humaines que je connaisse.
Vous avez aussi choisi de donner la parole à des femmes politiques comme Yaël Braun-Pivet ou Rachida Dati. C’était important pour vous de montrer des femmes de pouvoir ?
Oui, parce que c’est épuisant.
Je ne sais pas comment elles font. Il faut une volonté folle, ne jamais lâcher.
Yaël Braun-Pivet est mère de cinq enfants. Pour moi, la façon de vouloir régir la cité, le bien de la vie des autres, a à voir avec la maternité.
Et elle a pris des coups, notamment de son propre camp, qui a essayé deux fois de l’empêcher d’accéder à des postes importants : d’abord à la présidence d’une commission, puis à celle de l’Assemblée nationale.
On lui disait : « Occupe-toi de tes enfants », « on a prévu quelqu’un d’autre, un homme ».
Elle a dû se battre contre les siens. Je trouve ça incroyable.
Et Rachida Dati, c’est aussi un parcours incroyable : une famille extrêmement nombreuse, des parents analphabètes. C’est un destin français !
Il y a aussi des parcours lumineux, comme celui de Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde…
Oui, Nina Métayer, c’est la joie et la curiosité.
Je trouve que tous les enfants devraient lire son parcours. Elle dit : « Je ne sais pas faire grand-chose ».
Et puis elle part, elle vit ailleurs, elle s’intéresse à d’autres choses. Elle se dit : « Je vais faire du pain, ça me permettra de revenir vivre au Mexique ».
Tout s’enchaîne, les rencontres, le travail, et elle devient la meilleure pâtissière du monde.
C’est un parcours génial.
Vous vous revendiquez féministe. Comment vivez-vous cela en tant que journaliste ?
Je suis féministe, mais j’adore les hommes.
Je ne fais pas partie d’un féminisme qui ne peut pas les supporter. Je crois que de la mixité naît la lumière, de la variété des points de vue et des regards.
J’essaie de donner la parole aux femmes, de trouver des expertes, mais ce n’est pas facile.
Les femmes doutent énormément de leur légitimité.
Vous invitez une femme parce qu’elle a consacré quatre ans de sa vie à un sujet, elle vous dit : « Je ne suis pas sûre d’être légitime », et elle vous propose l’homme qui a écrit la préface. Lui, il est déjà au maquillage…
Il y a une vraie auto-censure des femmes.
Moi, j’essaie de leur donner la parole, de les inviter sur le plateau, mais il reste énormément de choses à faire.
D’ailleurs, je suis à fond pour les quotas. Une fois que ça passe, ça devient normal.
Les hommes ont été le quota pendant 2 000 ans. Maintenant, à nous.
Dans votre livre, vous décidez de vous livrer aussi. Pourquoi ce choix ?
À force de rencontrer ces femmes — d’abord pour le podcast RTL, puis le livre — j’ai dû interviewer une soixantaine de personnes.
Forcément, ça vous parle, ça fait résonner votre propre histoire.
Je me suis souvenue de choses que j’ai vécues jeune journaliste. Heureusement, les temps ont changé, parce que j’ai vu des choses pas possibles.
Et à un moment, je me suis dit que c’était un peu couard de se cacher derrière ces portraits. Après tout, j’en suis une aussi.
Si mon expérience peut servir à d’autres, il fallait que je le fasse.
Vous révélez notamment une agression subie à l’adolescence. Pourquoi maintenant ?
J’ai une éducation très « Kate Middelton », never complain, never explain, disait ma grand-mère.
On ne dit pas ce qu’on a vécu, sauf dans un cercle très privé, familial…
Mais je trouve que les choses avancent lentement, et qu’elles ont même tendance à se refermer pour les femmes.
J’entends des gens dire : « Depuis 2017, ça a beaucoup évolué, maintenant revenons aux choses sérieuses ».
C’est un piège qui se referme.
Or l’intime est politique. Le corps des femmes est politique.
Chaque pierre compte dans l’édifice de la parité et de l’égalité.
C’est pour ça que j’ai raconté ça.
Vous ne donnez pas le nom de votre agresseur, connu dans les médias. Pourquoi ?
Parce qu’il y a prescription.
C’est comme pour Flavie Flament : tout le monde connaissait le nom, mais elle ne pouvait pas le dire. C’est Thierry Ardisson qui a donné le nom de David Hamilton sur son plateau
Ce n’est pas très grave pour moi aujourd’hui — enfin, si, c’est grave, évidemment — mais l’essentiel, c’est de dire que nous sommes une masse.
Et que ça doit s’arrêter.
Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes femmes ?
Je pense à mes filles.
Il faut faire les choses qu’on a envie de faire.
Si vous voulez avoir cinq enfants et travailler, faites-le.
Si vous voulez ne pas travailler, faites-le.
Si vous voulez ne faire que travailler, faites-le.
Il faut être en cohérence avec ce qu’on est, faire des choix éclairés et les assumer.
Rester droites.
Ne rien laisser passer — avec humour, de façon paisible et joyeuse — mais ne rien laisser passer.
Il n’y a pas de justification à donner.
Soyez tenaces.
Retrouvez l’intégralité du podcast sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify…

