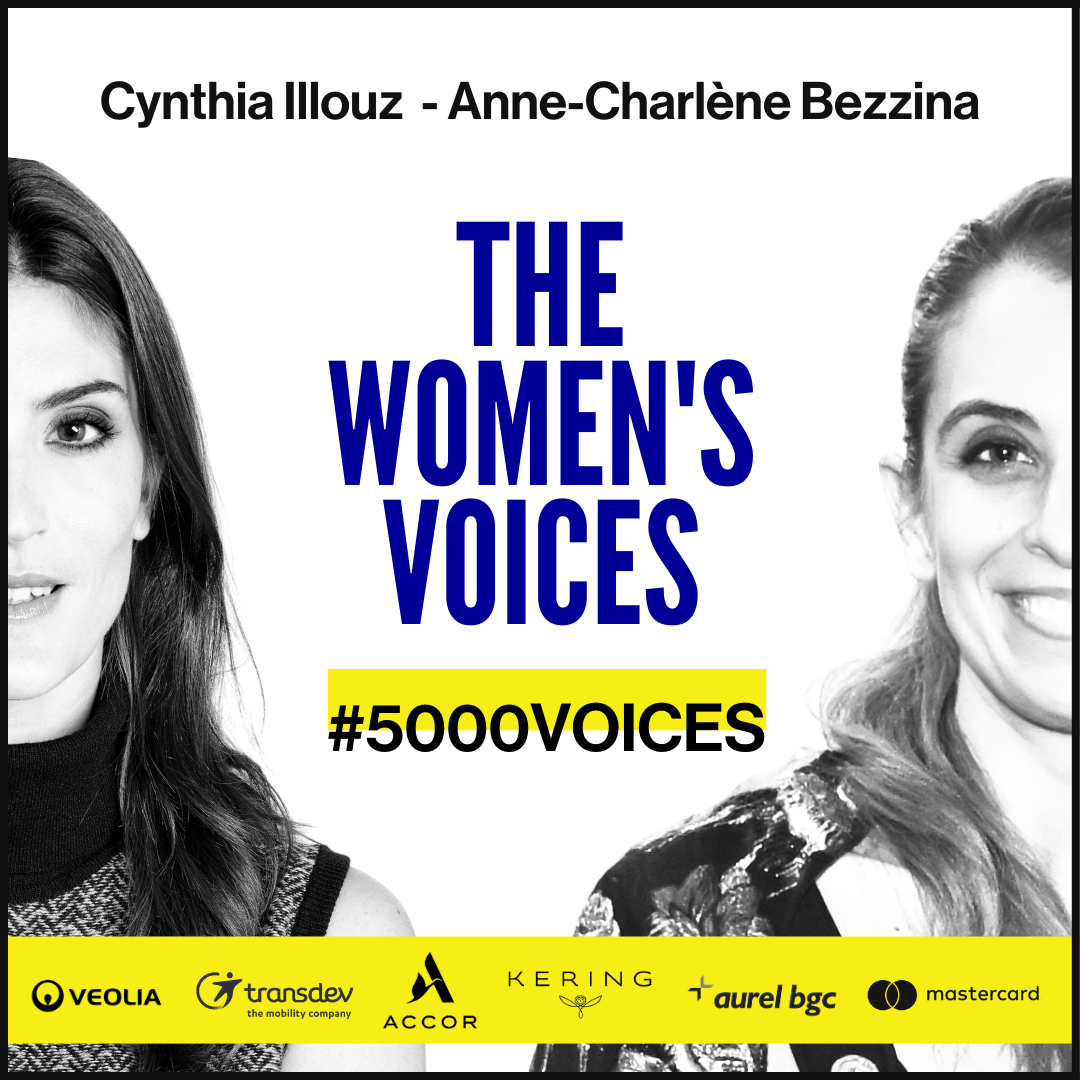Après la dissolution de l’Assemblée nationale, la France se retrouve sans majorité et dans une situation d’instabilité. L’élection présidentielle de 2027 s’annonce également décisive. Pour mieux comprendre, Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et autrice de l’ouvrage « Cette constitution qui nous protège » nous éclaire sur les mécanismes institutionnels.
Qu’est-ce que l’article 49-1, engagé récemment par François Bayrou?
L’article 49-1 de la Constitution permet au Premier ministre d’engager la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale. Concrètement, cela signifie que les députés votent pour ou contre la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cet outil sert en général à deux moments : soit juste après la nomination du Premier ministre, pour obtenir une base parlementaire solide, soit plus tard, pour confirmer un cap politique.
À côté de cela, vous avez l’article 49-3, beaucoup plus connu. Il permet de faire adopter un texte sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et adoptée. C’est pour cela qu’on parle parfois de « chantage constitutionnel » : l’Assemblée n’a alors que deux choix, renverser le gouvernement ou laisser passer le texte. L’usage répété du 49-3 a été vivement critiqué, car il traduit l’absence de majorité capable d’adopter une loi de manière classique.
Avec l’échec de la première dissolution, peut-on imaginer que le président dissout à nouveau l’Assemblée nationale ?
La dissolution relève de l’article 12 de la Constitution. Le président peut dissoudre l’Assemblée quand il le souhaite, à une seule exception : il doit attendre au moins un an après de nouvelles élections législatives. En pratique, après une dissolution et des élections qui n’ont rien réglé, il est contraint d’attendre ce délai d’un an avant de pouvoir à nouveau recourir à cet outil.
On entend de plus en plus parler de réformes institutionnelles, d’une éventuelle VIᵉ République ou encore de nouveaux mécanismes de cohabitation. Est-ce réaliste ?
On peut évidemment en débattre, mais il faut rappeler qu’un changement de Constitution est une décision lourde. Historiquement, en France, nous sommes passés d’une République à l’autre par des ruptures politiques majeures, souvent via une assemblée constituante. Aujourd’hui, le problème n’est pas tant les institutions que la crise politique : il n’existe pas de majorité claire. Si nous étions dans un système présidentiel comme aux États-Unis, la situation serait tout aussi bloquée quand le Congrès est divisé. Et dans un régime purement parlementaire comme en Grande-Bretagne, sans majorité claire issue des urnes, il n’y aurait pas non plus de gouvernement stable.
Qu’est-ce qui fait que la question du budget est aujourd’hui au cœur de cette crise ?
Parce que l’argent, c’est le nerf de la guerre politique. Le budget est l’acte politique par excellence : il traduit la ligne d’un gouvernement. Or, aujourd’hui, aucune majorité positive n’est capable de l’adopter. C’est ce blocage qui révèle l’ampleur de la crise.
En vue de la présidentielle de 2027 : si Marine Le Pen devait être déclarée inéligible, que se passerait-il ?
L’inéligibilité signifie qu’un citoyen perd à la fois son droit d’élire et d’être élu, en raison d’une condamnation pénale jugée suffisamment grave. Dans ce cas, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Elle aurait toutefois la possibilité de contester cette décision devant le Conseil constitutionnel, qui tranche en dernier ressort. En revanche, rien n’interdit qu’une personne condamnée occupe une fonction gouvernementale, puisque l’inéligibilité concerne uniquement les élections.
Pour conclure, diriez-vous que la Constitution nous protège encore dans cette situation ?
Oui, je le pense. La Constitution a été pensée pour résister aux crises. Nous traversons une crise politique, pas une crise institutionnelle. Le cadre constitutionnel, même sous tension, continue d’offrir un espace démocratique. La seule véritable issue viendra du choix des électeurs lors des prochaines échéances.